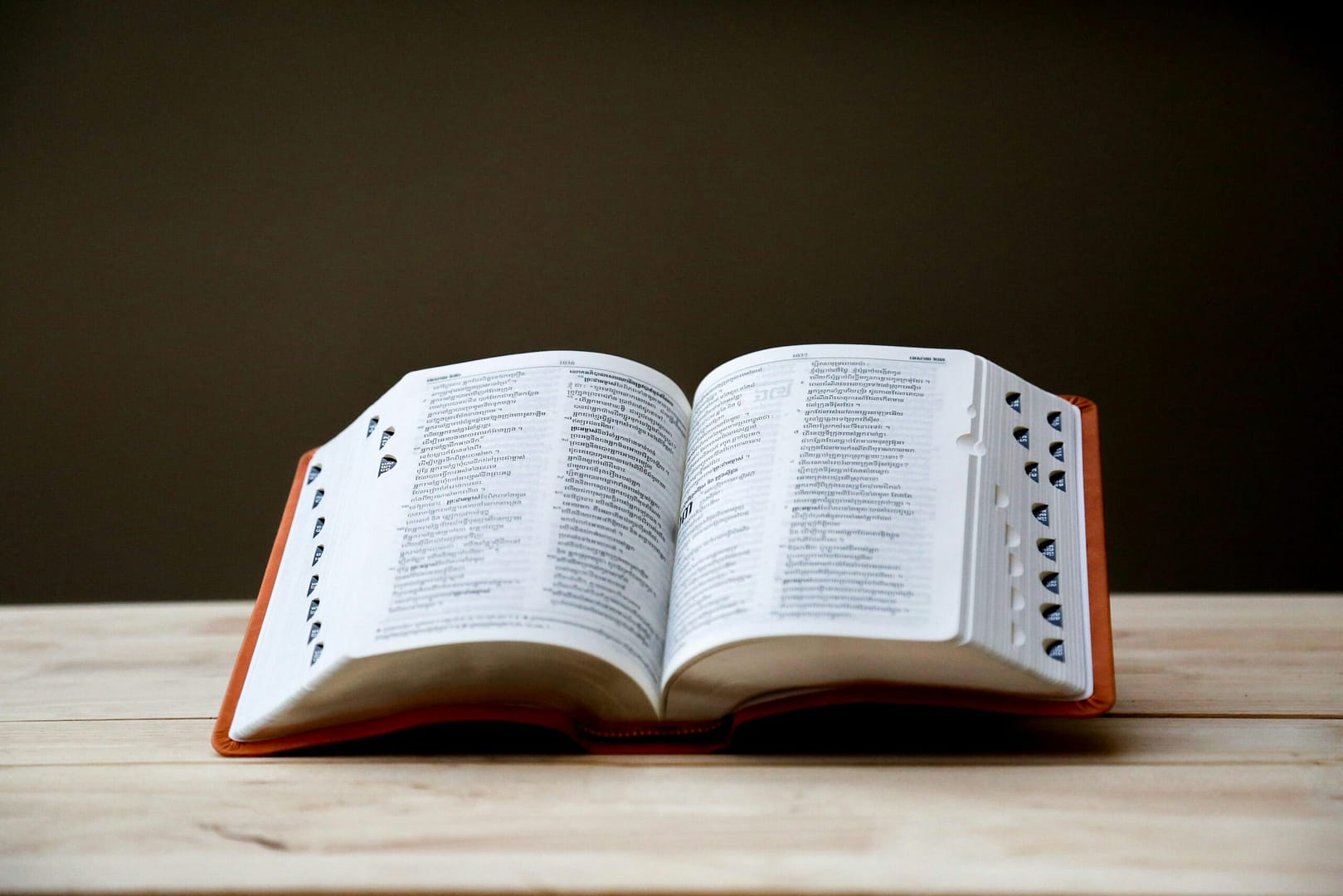Un manager en réunion, un parent à bout : quand les opposés frappent à la porte
Entre l’exigence de performance du lundi matin et l’épuisement du mercredi soir, l’équilibre ressemble parfois à une fiction.
Vous êtes peut-être ce cadre qui jongle entre indicateurs et responsabilités familiales, ou ce parent qui passe sans transition d’une posture de contrôle à une écoute empathique mise à l’épreuve.
Si cette tension vous est familière, vous n’êtes pas seul.
En psychologie jungienne, elle porte un nom : la conjonction des opposés.
Comprendre la conjonction des opposés : de la dualité au dialogue
Carl Gustav Jung décrit la psyché comme structurée par des pôles contradictoires mais fondamentaux :
le Moi et le Non-Moi, la Persona et l’Ombre, le Conscient et l’Inconscient.
L’enjeu n’est pas d’éliminer l’un au profit de l’autre, mais de créer un espace de dialogue symbolique où ces pôles cessent de s’affronter pour commencer à coexister.
Cette approche rejoint la psychologie culturelle de Jerome Bruner : nous ne faisons pas seulement l’expérience de la vie, nous la mettons en récit.
Le récit n’est pas un commentaire secondaire : il est la structure même de l’expérience psychique.
Du Moi au Soi : quand le récit permet l’unité
Le récit de soi devient alors un espace de transformation.
Il ne nie pas les tensions ; il les reconfigure.
Prenons une situation fréquente en consultation :
-
Persona : une responsable de projet efficace, performante, toujours sous contrôle.
-
Ombre : une femme sensible, envahie par l’anxiété, le doute ou la peur de décevoir.
Lorsque cette dualité reste clivée, elle épuise.
Lorsqu’elle est travaillée narrativement, elle se transforme :
l’efficacité devient une ressource d’organisation, la vulnérabilité une boussole émotionnelle.
En termes de thérapie des schémas, on observe souvent l’association d’un schéma d’exigence élevée (perfectionnisme) et d’un schéma de vulnérabilité (peur de l’échec ou de l’abandon).
Le travail psychologique vise alors l’émergence d’un mode adulte sain, capable de reconnaître ces schémas sans leur laisser les commandes.
Quand la tension devient symptôme
Lorsque les opposés restent trop longtemps en tension, ils cessent d’être féconds.
Ils deviennent source de fatigue, de répétition, de blocage ou de perte de sens.
C’est souvent à ce moment-là qu’un accompagnement psychologique devient pertinent :
non pour “choisir un camp”, mais pour transformer la tension en mouvement.

Le cinéma français s’en mêle : de Claude Sautet à Maïwenn
Le cinéma français en offre de nombreuses illustrations.
Dans Un cœur en hiver ou Polisse, les personnages ne trouvent d’issue que lorsqu’ils s’autorisent une vérité subjective : le récit qu’ils se racontent sur eux-mêmes évolue, devient plus intégré, plus cohérent.
Le cinéma met en scène ce que la clinique observe :
le changement advient quand l’histoire intérieure peut être réécrite.
Application clinique et pédagogique : faire du récit un levier
Favoriser la conjonction des opposés, que ce soit en thérapie, en pédagogie ou en accompagnement de dirigeants, consiste à :
-
Accueillir les ambivalences sans les classer comme bonnes ou mauvaises
-
Utiliser l’écriture, la mise en situation ou l’imaginaire symbolique pour reformuler les conflits internes
-
Lire les tensions à travers des figures archétypales (le héros, l’ombre, le guide) dans une logique de transformation
Réconcilier schémas et imaginaire
La thérapie des schémas, développée par Jeffrey Young, permet d’identifier les racines émotionnelles des comportements répétitifs.
Là où Jung propose une lecture symbolique, Young offre une cartographie émotionnelle.
Les deux approches convergent :
la transformation passe par l’intégration narrative.
Le schéma n’est pas supprimé ; il est nommé, situé, intégré.
Et vous, quel récit vous racontez-vous ?
Pensez-vous devoir toujours être fort, toujours calme, toujours performant ?
Et si cette exigence n’était qu’une part de vous-même, appelant une autre voix à être entendue ?
Ce type de tension intérieure est un motif fréquent de consultation.
Lorsqu’elle devient épuisante ou bloquante, il est possible d’en faire quelque chose, plutôt que de la porter seul.
Si ce que vous avez lu résonne avec votre situation actuelle, vous pouvez envisager un premier rendez-vous pour transformer cette tension en ressource.
#FAQ
Qu’est-ce que la conjonction des opposés en psychologie jungienne ?
C’est l’idée que la psyché humaine se structure autour de pôles contraires (comme le conscient et l’inconscient), et que le bien-être passe par leur intégration symbolique, non leur suppression.
Pourquoi ressent-on une tension entre différentes facettes de soi ?
Parce que notre psyché contient des forces contradictoires, souvent refoulées. Par exemple, une personne performante peut cacher une grande sensibilité.
Quel est le lien entre récit personnel et équilibre psychique ?
Le récit permet de donner sens à nos contradictions. Il aide à créer une narration où les tensions deviennent des éléments intégrés, et non des conflits destructeurs.
Comment la « Persona » et l’ »Ombre » interagissent-elles ?
La Persona est notre masque social, l’Ombre, ce que nous refoulons. Leur dialogue permet d’éviter les comportements rigides ou de rejet.
En quoi cette approche peut-elle aider en management ?
Elle permet aux managers de mieux se comprendre et de naviguer entre efficacité professionnelle et intelligence émotionnelle, sans sacrifier l’un pour l’autre.
Quels outils utiliser pour intégrer les opposés ?
L’écriture introspective, le jeu de rôle, l’analyse des archétypes, et la thérapie des schémas sont des outils puissants de transformation intérieure.
La conjonction des opposés concerne-t-elle tout le monde ?
Oui, chaque être humain possède des tensions internes. Ce concept universel nous invite à les accueillir pour grandir.
Le cinéma reflète-t-il cette notion ?
Absolument. Des films comme Polisse ou Un cœur en hiver montrent comment les personnages évoluent en intégrant leurs tensions internes.
Comment appliquer cela en pédagogie ?
En reconnaissant les ambivalences chez les apprenants, et en les aidant à en faire un récit transformateur plutôt qu’un blocage.
Existe-t-il un lien entre Jung et la thérapie des schémas ?
Oui. Jung offre une lecture symbolique, Young une cartographie émotionnelle. Les deux convergent vers une intégration narrative des blessures.